➡️➡️ En France, le salaire brut mensuel d’un sénateur s’élève à 7637.39 euros (source : senat.fr 2024).
Bien que moins médiatisés que les députés, les sénateurs exercent un pouvoir législatif tout aussi important et constituent un contre-pouvoir indispensable en adoptant ou rejetant les projets de loi proposés par le gouvernement ou par les parlementaires. Un sénateur a pour fonction de représenter la collectivité territoriale où il a été élu et assure ainsi une certaine stabilité institutionnelle. Il intervient aussi dans le processus législatif en défendant les intérêts des territoires et en veillant à la cohérence des politiques publiques.
Afin de leur donner les moyens de consacrer pleinement au mandat dont ils sont investis, sans dépendre financièrement de quiconque, la loi accorde aux sénateurs des indemnités mensuelles. Mais combien exactement ? Combien gagne un sénateur français selon ses responsabilités spécifiques ? La réponse dans cet article !
Qu’est-ce qu’un sénateur français ?
La définition du métier
Un sénateur est un membre du Sénat, la chambre haute du Parlement français. Élu pour un mandat de six ans, il représente les départements et les collectivités d’outre-mer. Contrairement aux députés, qui sont élus au suffrage direct par les citoyens, les sénateurs sont élus au scrutin universel indirect par un collège électoral d’environ 160 000 personnes. Un collège électoral qui se compose de grands électeurs tels que des sénateurs, députés, conseillers régionaux, conseillers départementaux… Comme le fait un député, un sénateur participe au travail législatif et contrôle l’action du Gouvernement.
Les missions d’un sénateur en France
Les missions des sénateurs et par extension du Sénat sont nombreuses et se complètent à celles de l’Assemblée nationale.
Fonction législative
- Participer à l’élaboration, à l’amendement et à l’adoption des lois.
- Proposer des amendements aux projets de loi soumis par l’Assemblée nationale.
- Initier des propositions de loi sénatoriales.
- Examiner et réviser les textes législatifs, en particulier ceux ayant un impact sur les territoires.
- Garantir la cohérence et la stabilité des lois en apportant une réflexion approfondie.
Contrôle de l’action gouvernementale
- Poser des questions orales et écrites aux ministres pour obtenir des réponses sur les actions du gouvernement.
- Créer des commissions d’enquête pour analyser en profondeur les décisions ou politiques gouvernementales.
- Vérifier la transparence et la responsabilité des actions exécutives.
- Contrôler l’application des lois et des décisions prises par le gouvernement.
Représentation des collectivités territoriales
- Défendre les intérêts des départements, régions et communes.
- Intervenir dans les débats législatifs concernant la décentralisation et le financement des collectivités locales.
- Participer à l’élaboration de lois qui concernent l’aménagement du territoire et les collectivités locales.
- S’assurer que les décisions nationales prennent en compte les réalités locales et régionales.
Les conditions d’exercice du métier
Les sénateurs exercent une fonction exigeante qui nécessite un engagement important en termes de temps et de disponibilité. Pendant les périodes de forte activité législative, comme l’examen du budget ou des réformes importantes, ils travaillent jusqu’à 19 h par jour. Bien qu’assez rarement, il leur arrive aussi de travailler toute la nuit lors des séances de nuit.
L’autre caractéristique de ce métier est qu’il exige des déplacements très fréquents. En raison de la nature de leurs responsabilités législatives et de leur rôle de représentant des territoires, les sénateurs doivent en effet jongler entre leur travail à Paris où se situe le siège du Sénat et les déplacements réguliers dans leur circonscription. Certains sénateurs font même le déplacement entre Paris et leur circonscription deux à trois fois par mois pour rencontrer des élus locaux, participer à des événements publics…
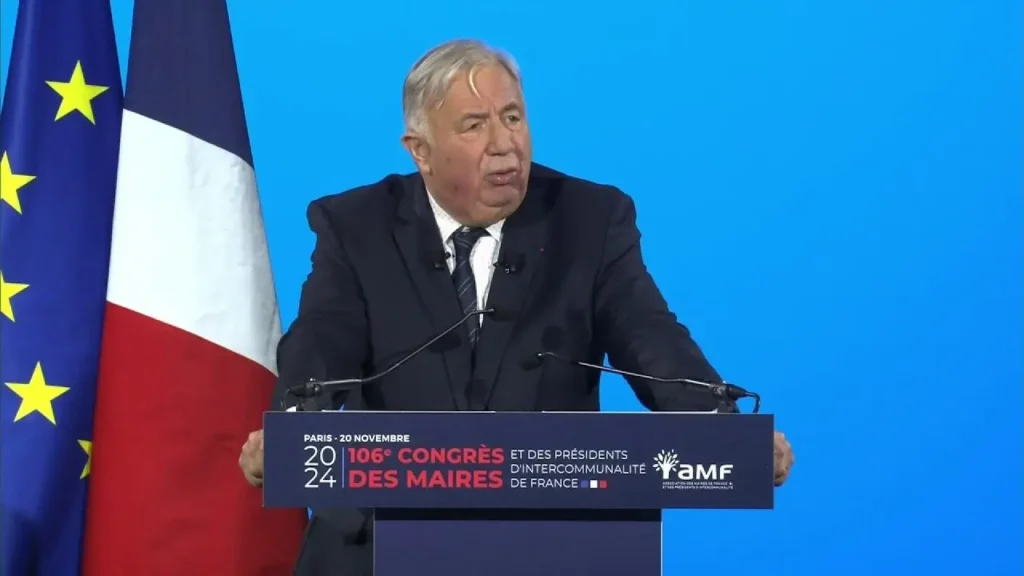
Quel est le salaire d’un sénateur ?
Salaire moyen d’un sénateur en France
En France, le montant brut mensuel de l’indemnité d’un sénateur s’élève à 7637.39 euros (source : senat.fr 2024). L’ordonnance portant loi organique n° 58-1210 du 13 décembre 1958 relative à l’indemnité des membres du Parlement distingue trois éléments constitutifs de cette indemnité :
- Indemnité parlementaire de base : 5931.95 euros ;
- Indemnité de résidence : 177.96 euros ;
- Indemnité de fonction : 1527.48 euros.
L’indemnité parlementaire de base constitue la rémunération principale d’un sénateur pour l’exercice de son mandat. Elle est destinée à couvrir le travail législatif et les fonctions associées à l’appartenance au Sénat, telles que la participation aux séances plénières, les travaux en commission, et les autres activités parlementaires. En ce qui concerne l’indemnité de résidence, elle est attribuée pour compenser les frais liés au logement du sénateur, notamment si celui-ci vit dans une autre région que Paris, où se situe le siège du Sénat. Par ailleurs, tous les sénateurs perçoivent une indemnité de fonction de 1 527.48 euros.
Les indemnités spéciales en fonction des responsabilités particulières
En complément de l’indemnité parlementaire, fixée à 7 637.39 euros, les sénateurs assumant des fonctions spécifiques perçoivent en plus des indemnités spéciales. Ces rémunérations supplémentaires visent à compenser la charge de travail accrue liée à ces responsabilités.
Ainsi, le Président du Sénat bénéficie d’une indemnité spéciale de 7 591.58 euros. Les questeurs, chargés de la gestion administrative et financière du Sénat, perçoivent quant à eux 4 444.97 euros. Les vice-présidents du Bureau, les présidents de groupe politique, les présidents de commission, les rapporteurs généraux et les présidents de délégation reçoivent chacun une indemnité de 2 184.30 euros. Le président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques bénéficie d’une indemnité de 2 016.27 euros. Enfin, les secrétaires du Bureau touchent une indemnité de 748.70 euros.
Voici un tableau récapitulatif des salaires bruts mensuels des sénateurs en fonction de leur poste au sein du Sénat :
| Responsabilités | Salaire brut/mois (€) | Indemnités spéciales (€) | Total brut/mois (€) |
| Sénateur sans fonction particulière | 7 637.39 | 0 | 7 637.39 |
| Président du Sénat | 7 637.39 | 7 591.58 | 15 228.97 |
| Questeurs (4 personnes) | 7 637.39 | 4 444.97 | 12 082.36 |
| Vice-présidents du Bureau | 7 637.39 | 2 184.30 | 9 821.69 |
| Présidents de groupe politique | 7 637.39 | 2 184.30 | 9 821.69 |
| Présidents de commission et rapporteurs généraux | 7 637.39 | 2 184.30 | 9 821.69 |
| Présidents de délégation | 7 637.39 | 2 016.27 | 9 653.66 |
| Président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques | 7 637.39 | 931.76 | 8 569.15 |
| Secrétaires du Bureau | 7 637.39 | 748.70 | 8 386.09 |
Comment devenir sénateur français ?
Les formations à suivre et diplômes requis
Le parcours pour devenir sénateur en France n’est pas fléché, et il n’existe pas de formation spécifique ou obligatoire pour accéder à ce mandat. En effet, aucun diplôme n’est requis pour se présenter à l’élection sénatoriale. Cependant, de nombreuses personnes qui aspirent à devenir sénateur choisissent de suivre des études en droit public, en sciences politiques ou en administration publique. Certaines ont fréquenté des institutions prestigieuses comme Sciences Po, des écoles de droit ou se sont formées à l’École Nationale d’Administration (ENA).
Bien que ce ne soit pas obligatoire, il est cependant recommandé de posséder un diplôme universitaire de niveau Bac+4 ou Bac+5 dans des domaines liés à la politique, au droit ou à l’économie, afin de mieux appréhender les enjeux législatifs et institutionnels du Sénat. Ces formations permettent d’acquérir les compétences nécessaires pour assumer les responsabilités d’un sénateur.
Parcours pour devenir sénateur
Le parcours typique d’un sénateur est un cheminement politique long et exigeant qui se construit progressivement. Il commence généralement par un engagement actif au sein d’un parti politique, où l’on gravit les échelons et développe un réseau solide. Cette implication se traduit dans la majorité des cas par des mandats locaux (conseillers municipaux, députés, maires, etc.) grâce auxquels l’intéressé acquiert une expérience concrète de la gestion publique. Une fois ce socle établi, il peut enfin se présenter aux élections sénatoriales.
En France, les sénateurs sont élus au suffrage indirect, c’est-à-dire qu’ils sont choisis par un collège d’élus locaux (grands électeurs), et non par le grand public. Pour se présenter, un candidat doit obtenir le soutien d’un nombre suffisant d’élus locaux (maires, conseillers régionaux, etc.). Les élections sénatoriales ont lieu tous les trois ans, avec un renouvellement par moitié des sièges du Sénat.
Les conditions de candidature et d’éligibilité
Pour se présenter aux élections législatives ou sénatoriales, il faut être majeur, de nationalité française, jouir de ses droits civils et politiques, et ne pas être frappé d’une incapacité ou d’une inéligibilité prévue par la loi. Il existe en tout deux catégories d’inéligibilités : les inéligibilités liées à la personne (condamnations pénales, non-paiement de certaines dettes à l’État ou à des collectivités publiques…) et les inéligibilités liées aux fonctions. Par exemple, certains hauts fonctionnaires comme les préfets, magistrats, officiers, recteurs et fonctionnaires territoriaux n’ont pas le droit de se présenter à une élection sénatoriale.
Quels métiers se rapprochent le plus d’un sénateur ?
Député
En France, un député est élu pour représenter la population à l’Assemblée nationale. Son rôle consiste à légiférer, à contrôler le gouvernement, et à défendre les intérêts de ses électeurs. Il participe aux débats parlementaires, examine les lois, et vote les projets de loi. Comme les sénateurs, les députés exercent un mandat électif et ont des responsabilités législatives. Cependant, les députés siègent à l’Assemblée nationale, tandis que les sénateurs siègent au Sénat. Les deux rôles sont complémentaires dans le processus législatif.
Maire
Le maire est élu pour diriger une commune, gérer les services publics locaux, et représenter la municipalité à l’échelle nationale. Il préside le conseil municipal, met en œuvre les politiques publiques locales et assure la gestion administrative de la commune. Tout comme un sénateur, le maire est élu pour représenter les citoyens. Les deux ont un rôle de leadership et de décision, mais à des échelles différentes.
Conseiller municipal ou régional
Également élu, un conseiller municipal ou régional a pour fonction de représenter les citoyens au niveau local ou régional. Il prend part à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques dans son domaine géographique. Comme les sénateurs, les conseillers municipaux et régionaux participent à des décisions importantes pour la collectivité. Toutefois, les sénateurs légifèrent à l’échelle nationale, tandis que les conseillers travaillent à des échelles locales ou régionales.
| Métier | Rôle principal | Responsabilité législative ou politique | Échelle d’intervention |
| Sénateur | Légiférer, contrôler le gouvernement, défendre les intérêts des citoyens | Législation, contrôle de l’action gouvernementale | Nationale |
| Député | Représenter la population, légiférer, contrôler le gouvernement | Législation, contrôle de l’action gouvernementale | Nationale |
| Maire | Diriger une commune, gérer les services publics locaux, représenter la municipalité | Leadership, gestion des politiques locales, décisions administratives | Locale |
| Conseiller municipal | Représenter les citoyens au niveau local, participer à l’élaboration des politiques publiques | Gestion des politiques publiques locales | Locale |
| Conseiller régional | Représenter les citoyens au niveau régional, élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques | Élaboration et mise en œuvre des politiques publiques régionales | Régionale |
